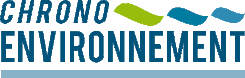L’évolution paléoclimatique du Jura Suisse depuis le dernier maximum glaciaire : une étude palynologique et géologique du site des Amburnex (Jura vaudois)
Anne-Marie Rachoud-Schneider, spécialiste en palynologie et paléobotanique et Brahimsamba Bomou, spécialiste en sédimentologie, géochimie sédimentaire et paléoclimatologie, viendront présenter leurs travaux sur la tourbière des Amburnex, le lundi 10 mars à partir de 14h, salle -107 M, au laboratoire Chrono-environnement, Campus de la Bouloie, à Besançon.
Résumé:
Juché sur les hauteurs du Jura vaudois, le site des Amburnex nous offre un cadre exceptionnel pour le développement de larges zones de tourbières. Ces zones humides, connue pour leur vulnérabilité, offrent un intérêt écologique de premier plan avec la présence d’une flore endémique telle que la Saxifrage dorée, mais également un intérêt géologique avec un enregistrement sédimentaire lacustre depuis plus de 19000 ans. En effet, avant d’être une tourbière cette zone était un lac tardiglaciaire qui s’est formé peu après le retrait des glaciers à la fin de la dernière glaciation du Würm. Au fur et à mesure du remplissage de ce dernier par des dépôts sédimentaires issus de l’altération des reliefs environnants ainsi que de la production biologique lacustre, ce lac s’est peu à peu comblé et transformé en tourbière avec le développement d’une végétation typique telle que les sphaignes. Le milieu est ainsi passé d’un environnement oxygéné avec une faune de bivalves et de petits gastéropodes à un environnement pauvre en oxygène et très acide permettant le développement d’une flore très particulière inféodée à ces milieux extrêmes. L’accumulation de la matière organique non dégradée issue de ces végétaux dans ces conditions spéciales va permettre de produire de la tourbe et former ainsi ces tourbières, phase ultime des lacs glaciaires.
Le projet développé par l’Institut des Sciences de la Terre de l’Université de Lausanne, conjointement avec le département de botanique du Naturéum, est d’étudier l’évolution environnementale et climatique enregistrée dans les sédiments lacustres depuis ces derniers 19000 ans ainsi que les enregistrements des épisodes volcaniques majeurs ayant ponctués cette période, et ce grâce à des analyses géochimiques, minéralogiques et polliniques. En effet, les outils minéralogiques et géochimiques, on peut déterminer l’évolution du régime climatique en caractérisant les températures et l’intensité des précipitations, mais aussi les conditions environnementales. Ces analyses sont confirmées par une analyse pollinique (étude des pollens) qui permet de caractériser l’évolution des assemblages des végétaux typiques d’un milieu et d’un climat donné. L’évolution du niveau trophique du lac est quant à lui déterminé par la concentration en phosphore qui est un traceur couramment utilisé pour indiquer le taux de nutriment dans les eaux. Grâce notamment à la susceptibilité magnétique, un événement volcanique a pu être enregistré dans ce site et correspondrait au volcanisme du Laacher See (Allemagne) datant d’il y a 13000 ans.
Anne-Marie Rachoud-Schneider possède plus de 40 ans d’expérience en recherche et enseignement. Titulaire d’un doctorat en sciences naturelles de l’Université de Berne, elle a travaillé sur des projets de recherche en palynologie, géobotanique ainsi qu’en archéobotanique, collaborant notamment avec des institutions prestigieuses comme l’Université de Lausanne, le Musée Botanique de Lausanne et Météo Suisse. Passionnée par les fouilles archéologiques, elle a mené des travaux sur divers sites en Suisse, Belgique, Italie.
Brahimsamba Bomou a travaillé principalement sur la reconstruction paléoenvironnementale et paléoclimatique lors de grandes crises géologiques dans différents environnements de dépôts. Après un Bachelor en Sciences de la Vie et de la Terre à l’Université de Rouen (2004), suivi d’un Master en Sédimentologie et Paléontologie à l’Université de Bourgogne (2007), il obtient un doctorat à l’Institut de Géologie et Paléontologie de l’Université de Lausanne en 2012. Il poursuit ses recherches en tant que Post-Doc à l’IPGP et au LSCE avant de devenir Maître assistant à l’Université de Corse. De retour à l’Université de Lausanne, il occupe successivement les postes de Maître assistant et Chargé de Laboratoire , avant d’être nommé Maître d’Enseignement et Recherche à l’Université de Lausanne.